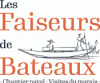Le marais audomarois: histoire, faune, flore et traditions
Le marais de Saint Omer, un espace naturel reconnu par l’Unesco
Le marais de Saint-Omer et de Clairmarais: destination incontournable de l’Audomarois
À seulement 40 minutes de Calais et Dunkerque, et 1 heure de Lille, le marais audomarois vous ouvre les portes d’un monde à part. Ce joyau naturel des Hauts-de-France vous attend pour une escapade dépaysante, riche en histoire et en authenticité.
Au programme : visites guidées en bateau, balades en barque à rames ou à moteur, randonnées à pied ou à vélo, et sorties culturelles dans la belle ville de Saint-Omer. Une vraie bouffée d’oxygène entre ville et nature !
Situé entre la Flandre intérieure à l’Est et les collines de l’Artois à l’Ouest, le marais audomarois s’étend sur 15 communes du Nord et du Pas-de-Calais. Parmi elles : Saint-Omer, Clairmarais, Serques, Éperlecques, Houlle, Moulle, Salperwick, Tilques, Saint-Martin-lez-Tatinghem, Longuenesse, Arques, Watten, Saint-Momelin, Noordpeene et Nieurlet.

Le marais audomarois en quelques mots
Ce labyrinthe de terre et d’eau s’étend sur 3 700 hectares (soit 37 km²), parcouru par plus de 700 kilomètres de cours d’eau, dont 170 sont navigables ! Ces chiffres témoignent de l’immensité de ce joyau naturel, classé Réserve de biosphère par l’UNESCO. Mais au-delà de ses dimensions, le marais audomarois impressionne aussi par sa richesse historique et son rôle écologique majeur.
Autrefois, cette vaste zone humide tourbeuse était encore influencée par les grandes marées via le fleuve de l’Aa, notamment à l’époque carolingienne. Peu à peu, les Hommes se sont approprié ces terres : les moines de Sithiu (l’ancien nom de Saint-Omer) et de l’abbaye de Clairmarais y extrayaient la tourbe. Les agriculteurs ont poldérisé les sols, creusé des canaux de drainage pour évacuer l’eau vers la mer, et canalisé les bras d’eau principaux pour permettre l’essor du commerce à Saint-Omer.
Au XIXe siècle, le marais prend sa forme actuelle : un espace à la fois habité, sauvage et cultivé. Les maraîchers y perpétuent encore la tradition du chou-fleur d’été de Saint-Omer et de l’endive d’hiver.
Destination discrète mais pleine de surprises, le dernier marais maraîcher de France ravit les randonneurs, les pêcheurs et les amateurs de nature en quête de calme et d’authenticité.
Montez à bord des embarcations traditionnelles — les escutes et les bacôves — pour une balade au fil de l’eau. Les derniers faiseurs de bateaux de la région vous invitent à vivre une croisière unique, au cœur d’un paysage façonné par l’Homme et préservé par la nature.
Découvrons ensemble le marais audomarois : son histoire, sa faune, sa flore… et ses secrets bien gardés.
Au sommaire
Le marais audomarois en quelques chiffres
Comme indiqué plus haut, le marais audomarois s’étend sur 3 726 hectares, soit un peu plus de 37 km². Il s’agit de la plus grande zone humide de toute la région des Hauts-de-France.
Pour donner un ordre d’idée, le marais est environ 12 fois plus vaste que les hortillonnages d’Amiens, et il compte 4 fois plus de rivières. Cette vaste cuvette naturelle affiche en moyenne une altitude de 0 mètre, et certains points peuvent descendre jusqu’à un mètre sous le niveau de la mer. Une configuration qui rend la zone très vulnérable aux montées des eaux.
Si quelques centaines d’hectares appartiennent à des acteurs publics (la Région Hauts-de-France, le Département du Pas-de-Calais, Eden 62, les communes de Saint-Omer et Clairmarais, le Parc naturel régional, le Conservatoire du littoral…), 90 % du marais est privé.
On y compte plus de 13 000 parcelles réparties entre 5 000 propriétaires.
Sur le plan agricole, le marais comprend environ :
450 hectares de maraîchage (dont le célèbre chou-fleur de Saint-Omer) ;
300 hectares de cultures diverses (notamment des céréales) ;
1 000 hectares de prairies, dont une partie est consacrée à l’élevage bovin et ovin.
Cette mosaïque de propriétaires et d’usages fait du marais audomarois un territoire vivant, agricole et fragile, à la fois façonné par l’homme et soumis aux aléas naturels.

Le marais audomarois: 13 siècle de labeur
Le marais de Saint-Omer durant l'Antiquité
Nous disposons de peu d’informations précises sur le marais audomarois durant l’Antiquité. Ce territoire, alors intégré à celui des Morins — la Morinie —, abritait déjà une vaste cuvette marécageuse, régulièrement inondée par le fleuve de l’Aa. Les hommes y pratiquaient sans doute la pêche, l’une des rares activités possibles dans ce milieu encore sauvage.
Après la chute de l’Empire romain, les choses deviennent plus claires. Le fleuve Aa inondait le marais entre Saint-Omer et le goulet de Watten-Éperlecques, avant de rejoindre la mer en traversant la Flandre maritime. Cette dernière ressemblait alors à un golfe côtier, que les textes anciens nomment Portus Itius, dont l’étendue variait selon les marées.
Le marais audomarois, constitué d’eau douce, pouvait ainsi contenir de l’eau saumâtre dans sa partie la plus occidentale, notamment autour de Watten.
C’est dans ce milieu inhospitalier, humide et mouvant que débute l’histoire de Saint-Omer.
Un marais développé par les moines au début du Moyen Age
Au VIIe siècle, sous le règne de Dagobert Ier, trois moines venus de Luxeuil — Mommelin, Bertin et Ebertram — s’installent en Morinie. Leur mission : convertir le peuple païen des Morins au christianisme. À leur tête, l’évêque Audomar de Thérouanne, une figure puissante du clergé de l’époque.
Le premier monastère est fondé sur le site actuel de Saint-Mommelin. Mais l’endroit, trop exposé aux inondations et aux attaques, s’avère rapidement inadapté.
Selon la légende, les trois moines embarquent alors à bord d’une barque et se laissent porter par les eaux, priant Dieu de les guider. Ils finissent par accoster sur les hauteurs de Sithiu, un lieu plus favorable, à l’abri et plus élevé.
Une autre version de la légende raconte que ces terres appartenaient à un pirate nommé Aldroad. Converti par Audomar, celui-ci aurait offert l’ensemble de ses terres au clergé, englobant les territoires des futures communes de Saint-Omer, Clairmarais et Arques.
De Sithiu à Saint-Omer, place forte du Nord
Contrairement à Saint-Mommelin, situé en bordure du marais et proche du golfe de Portus Itius, Sithiu offrait de nombreux avantages :
Une élévation naturelle de 12 mètres, idéale pour repérer les ennemis
Un marais ceinturant les lieux aux trois quarts, formant un rempart naturel efficace
Ce choix stratégique s’avéra judicieux, car Saint-Omer subira plusieurs vagues d’invasions vikings au IXe siècle (→ voir notre article dédié).
Progressivement, le site se développe : construction de l’abbaye d’en-bas (Saint-Bertin, initialement dédiée à Saint-Pierre), de l’église d’en-haut (future cathédrale), puis d’un bourg de pêcheurs.
Dès le Xe siècle, Saint-Omer devient un lieu de marché dynamique à la croisée de la Flandre et de l’Artois.
Aux XIIe et XIIIe siècles, elle devient un port de commerce important, un bastion religieux et administratif, et un foyer intellectuel de la contre-réforme durant la Renaissance.
Saint-Omer se développe dès le IXème siècle
Au IXe siècle, les moines entreprennent les premiers aménagements hydrauliques du marais. L’un des projets majeurs est le détournement du fleuve Aa vers Arques, grâce à la création du canal de la Basse-Meldyck. Ce canal, dont le nom signifie “farine” en flamand (maldyck), permet d’alimenter un moulin local.
Un second ouvrage, la Haute-Meldyck, est ensuite creusé pour acheminer l’eau jusqu’au pied de l’abbaye de Saint-Bertin.
Vers le Xe siècle, les premières opérations de poldérisation débutent dans le marais audomarois. Le principe : assécher certaines parties du marais pour gagner des terres cultivables.
Les sillons laissés par l’Aa dans la cuvette marécageuse sont alors élargis et approfondis pour faciliter l’écoulement des eaux. La vase extraite est utilisée pour rehausser les terres agricoles et d’élevage.
Cette technique est appliquée progressivement, dans un ordre logique : des marais hauts (en périphérie des bourgs) vers les marais bas (au cœur du marais). Ce processus de conquête foncière s’étend jusqu’à la fin du XVIIe siècle.
À partir de là, on adopte les techniques venues des polders hollandais : mise en casier du marais bas, digues, portes d’eau, et moulins d’épuisement à vent pour gérer les niveaux.
En 1866, la conquête des terres prend fin : plus aucune terre nouvelle ne sera “gagnée sur l’eau”.
Travaux de canalisation et ère du commerce maritime
Outre la création de terres agricoles et de fossés de drainage appelés watergangs, les habitants durent aussi lutter contre les inondations et développer la navigation.
Vers l’an 1100, un vaste canal nommé Nova A — ou “Grand Large” — est creusé. Il traverse les marais de Salperwick, Tilques, Serques, Houlle et Moulle.
Ce nouvel axe fluvial permet à des bateaux plus imposants de circuler et facilite l’écoulement des eaux de l’Aa vers la mer, réduisant ainsi les risques d’inondation.
En 1165, la Grande Rivière est à son tour transformée en canal. Elle dessert les ports intérieurs de Saint-Omer — notamment le quai du Haut-Pont, le Vain quai et le quai des Salines —, et les relie au port maritime de Gravelines. Cette réalisation est initiée par le comte Philippe d’Alsace.
Ces aménagements hydrauliques ont un double objectif : drainage et développement économique.
En parallèle, le comte de Flandre Baudouin VII poursuit les travaux engagés par son prédécesseur, Baudouin VI, qui avait déjà relié le bassin de la Lys à celui de l’Aa via un large fossé défensif. Ce fossé deviendra plus tard le célèbre canal de Neuffossé.
Enfin, pour mieux contrôler l’eau en aval, une digue est construite sur le littoral flamand, permettant de contenir les grandes marées et de sécuriser les terres en amont.

Quelques dates clefs dans l'évolution du marais audomarois
L’histoire du marais audomarois est aussi marquée par une série d’aménagements techniques majeurs. En voici quelques étapes déterminantes :
1681 : Création du canal de Calais, visant à améliorer les connexions fluviales vers la mer.
1699 : Construction de l’écluse Vauban à Gravelines. Elle permet de réguler les grandes marées en se fermant pour empêcher l’eau de mer d’envahir l’Aa, et en s’ouvrant pour faciliter son écoulement vers la mer.
1753 : Création du canal de Neuffossé, reliant l’Aa à la Lys. Ce projet renforce les axes de navigation entre la mer du Nord et l’intérieur des terres. C’est ce canal qui se verra doté d’un ascenseur à bateaux (des Fontinettes). Ce dernier était capable de fairte passer un dénivelé de 13,13m aux péniches!
À partir de là, les voies navigables permettent, notamment durant la Révolution industrielle, de relier Dunkerque à Lille via une série de canaux :
canal de la Colme,
canal de l’Aa,
canal de Neuffossé,
Canal de la Lys,
puis la Deûle.
Cette organisation fluviale intègre pleinement Saint-Omer dans les grandes routes du commerce fluvial du Nord.
1958 : Dernier grand bouleversement du marais audomarois avec la fermeture du bief du Haut-Pont et la création du canal à grand gabarit. Ce nouveau tracé contourne la ville pour accueillir des péniches bien plus grandes que les anciens modèles Freycinet.
Depuis lors, les bateaux lourds sont exclus de la ville et traversent directement l’espace naturel, modifiant profondément la géographie et les usages du marais. En 1967, l’ascenseur à bateaux des Fontinettes est définitivement remplacé par une écluse à haute chute.
Un espace reconnu par l'UNESCO ainsi que d'autres prestigieux labels
RAMSAR et PNR
Le marais audomarois est alimenté par un réseau hydraulique complexe :
le fleuve Aa,
les eaux de pluie et de ruissellement,
ainsi que deux nappes phréatiques profondes, qui jouent un rôle clé dans son équilibre écologique.
Ce territoire est l’une des deux grandes zones humides d’importance nationale et internationale de la région Nord–Pas-de-Calais, aux côtés de la zone Scarpe–Escaut.
Il bénéficie à ce titre de plusieurs protections officielles :
Il est classé zone Ramsar, selon la Convention internationale de Ramsar signée en 1971 pour la préservation des zones humides majeures dans le monde.
Il comprend également un Parc naturel régional (PNR), celui des Étangs du Romelaëre, reconnu pour sa biodiversité remarquable et son rôle de régulation hydraulique.
Cette reconnaissance confirme l’importance du marais audomarois comme réservoir de biodiversité, régulateur des crues, et patrimoine naturel d’exception.
Depuis 2013, le marais audomarois est également classé Réserve de biosphère par l’UNESCO, dans le cadre du programme MAB (Man and Biosphere).
Cette reconnaissance consacre l’équilibre unique entre un écosystème naturel remarquable et un territoire façonné par l’activité humaine depuis plus de mille ans.
Ici, l’Homme et la nature sont interdépendants. Sans interventions régulières — comme le curage des canaux, le faucardage ou l’entretien des berges —, le marais retournerait peu à peu à son état sauvage d’autrefois : une zone humide impénétrable et difficile à habiter.
Ce travail de gestion et d’entretien, transmis de génération en génération, est ce qui permet aujourd’hui au marais audomarois de rester :
habité,
cultivé,
et accueillant pour une biodiversité exceptionnelle.
Le marais de Saint-Omer: un entretien perpétuel
Un marais entretenu, habité et partagé
L’entretien du marais audomarois est aujourd’hui confié à la septième section des wateringues, une structure dédiée à la gestion de l’eau. Selon les saisons, ses agents interviennent pour :
curer les rivières,
faucarder les algues,
et renforcer les berges, notamment grâce à la technique du fascinage (pose de fagots pour stabiliser les rives).
Pour mener à bien ces opérations, des équipements spécialisés sont mobilisés : grues, chalands, faucardeuses…
Autrefois, ces tâches étaient réalisées à la main, à l’aide d’outils traditionnels comme :
le trouspa (pour refaire les berges),
l’édrack (pour creuser les fossés),
la grèpe (pelle pour extraire la tourbe),
la baguernette (épuisette solide pour tirer la vase).
Aujourd’hui, le marais est un territoire vivant et partagé. On y croise :
des habitants,
des maraîchers et éleveurs,
des pêcheurs, chasseurs, promeneurs et touristes,
ainsi que des sportifs, notamment en canoë ou à vélo.
Tous cohabitent dans le respect d’un fragile équilibre, nécessaire à la préservation de ce milieu naturel d’exception.
Le marais audomarois dans le réseau mondial des réserves de biosphère
Depuis 2013, le marais audomarois fait partie des 12 réserves de biosphère françaises reconnues par l’UNESCO, aux côtés de territoires emblématiques tels que :
la Camargue,
les Cévennes,
la forêt de Fontainebleau,
les Gorges du Gardon,
l’archipel de la Guadeloupe,
ou encore la vallée du Fango en Corse.
Il est intégré au réseau mondial MAB (Man and Biosphere), qui vise à :
réduire la perte de biodiversité,
améliorer les moyens de subsistance des populations locales,
soutenir un développement durable,
et favoriser les échanges d’expertise à l’échelle mondiale.
Ce classement conforte le marais audomarois dans son rôle de laboratoire vivant, où l’équilibre entre nature, culture et développement humain est au cœur des priorités.
Le patrimoine naturel : la faune et la flore du marais audomarois
Grâce à son climat tempéré, à l’abondance de l’eau et à ses sols tourbeux riches, le marais audomarois abrite une flore exceptionnelle.
On y recense :
plus de 100 espèces végétales remarquables,
dont 25 espèces protégées,
et plus de 60 communautés végétales, certaines très rares ou menacées.
À lui seul, le marais héberge 50 % de la flore aquatique de la région Nord–Pas-de-Calais. Un véritable sanctuaire végétal, unique en son genre !
Côté faune, les derniers inventaires sont tout aussi impressionnants :
240 espèces d’oiseaux nichent ou transitent par le marais, parmi lesquelles :
le blongios nain,
le butor étoilé,
le busard des roseaux,
le grèbe huppé,
et le martin-pêcheur.
26 espèces de poissons peuplent ses eaux : brochets, sandres, anguilles européennes…
Et dans les watergangs, rivières et étangs, vivent de nombreux amphibiens (grenouilles vertes et rousses), libellules et couleuvres à collier.
Certaines espèces sont aujourd’hui menacées, comme l’anguille commune d’Europe, victime de la fragmentation des cours d’eau.
D’autres, en revanche, prolifèrent de manière problématique : c’est le cas du rat musqué, qui creuse des galeries dans les berges et endommage les cultures des maraîchers.

Patrimoine culturel du marais audomarois et vieux souvenirs
Le visiteur amateur de vieilles pierres ne peut traverser l’Audomarois sans s’arrêter dans la vieille ville de Saint-Omer. Sa cathédrale majestueuse, ses ruelles anciennes et son riche passé en font une étape incontournable.
Autour de la ville, les villages du marais témoignent eux aussi d’un patrimoine remarquable. À Clairmarais, on admire encore une ancienne ferme médiévale, les ruines de l’abbaye cistercienne, la réserve des étangs du Romelaëre et la forêt domaniale de Rihoult-Clairmarais.
À pied, à vélo ou en barque, la destination séduit par son charme intemporel. Ce n’est pas un hasard si, dès le XVIIe siècle, les bourgeois de Saint-Omer et de Clairmarais appréciaient les fameuses « promenades d’eau ».
Les récits anciens affirment même que tout bon visiteur se devait de contempler les « îles flottantes » du marais. Il s’agissait alors d’amas de terre et de végétation formant de véritables radeaux naturels, dérivant au fil de l’eau.
Le roi Louis XIV lui-même, après avoir pris Saint-Omer en 1677, s’y serait attardé.
Ces îles flottantes ont aujourd’hui disparu, englouties peu à peu par leur propre poids ou détruites par les aménagements hydrauliques successifs. Mais leur souvenir flotte encore dans l’atmosphère du marais…
Des origines flamandes
En parcourant le marais audomarois, le promeneur attentif remarquera de nombreux noms de rivières, de fossés ou de lieux-dits aux consonances néerlandaises.
Des noms comme Stackelwaert, Hongarwaert, Bogarwaert, Petite Meer, Grande Meer, Westbrouck, Petit Leeck ou Grand Leeck rythment le paysage, en particulier dans les marais de Saint-Omer, Clairmarais, Saint-Martin-lez-Tatinghem, Salperwick, Tilques et Serques.
Ces appellations sont les vestiges linguistiques de l’origine flamande de l’Audomarois et témoignent de l’ancienneté du réseau hydraulique.
Voici quelques clés de compréhension :
Meer signifie “lac” → les “Petite” et “Grande Meer” sont d’anciens lacs aménagés en polders ;
Leeck signifie “fuite” ou “exutoire d’un polder” ;
Waert = canal ;
Brouck = marécage ;
Strom = courant ou flux.
Ces termes reflètent un rapport ancien, très technique, entre les hommes et l’eau, issu de la culture flamande.
D’autres noms, cette fois francisés, sont apparus plus récemment. Ils désignent souvent des canaux ou zones aménagés après le rattachement de Saint-Omer à la France au XVIIe siècle.
C’est le cas de noms comme :
La Redoute,
La Canarderie,
La Rivièrette,
Le Mussent,
ou encore des zones autrefois connues pour leurs îles flottantes.
Cette toponymie contrastée raconte l’histoire du territoire, entre culture flamande, aménagement hydraulique et influence française.
Un habitat rural spécifique - La maison du marais traditionnelle
Un habitat traditionnel, témoin du marais d’antan
Le marais audomarois conserve encore de belles maisons flamandes traditionnelles, notamment dans les anciens faubourgs maraîchers.
Certaines longères arborent un toit simple, d’autres un toit à la Mansart, composé de quatre pans.
On trouve encore, çà et là, de vieilles maisons maraîchères, parfois accompagnées de :
granges en bois,
serres,
cuisines à légumes,
hangars agricoles,
salles de forçage pour les endives,
et d’un pucheau : petit quai utilisé pour accoster la barque et puiser l’eau (“puchoir”) pour les besoins domestiques.
Le paysage porte aussi les traces d’aménagements anciens aujourd’hui souvent délaissés :
moulins de pompage,
vis d’Archimède métalliques,
batardeaux,
vannes et portes d’eau.
Tous ces éléments, tout comme les maisons en torchis ou briques jaunes, tendent malheureusement à disparaître.
Faubourgs et villages du marais habité
Des lieux emblématiques comme le faubourg de Lyzel, surnommé la « petite Venise du Nord », témoignent encore de cette vie rurale singulière. Mais pour combien de temps ?
On retrouve également ce charme du marais habité dans le faubourg du Haut-Pont ou le lieu-dit du Doulac.
Les maisons maraîchères y font face à la route. À l’arrière, les jardins s’ouvrent sur le marais et les rivières, prolongeant la vie domestique jusqu’aux berges.
Un marais entre tradition et villégiature
Plus à l’ouest, vers Salperwick, le marais habité cède la place à un paysage de villégiature.
On y voit fleurir de petites maisons de vacances, des campings et des berges aménagées, prisées par les pêcheurs.
Ce nouveau visage du marais reflète l’évolution des usages, entre héritage rural et loisir contemporain.
Il était une fois, les maraîchers de Saint-Omer
Le marais fut mis en culture dès ses premiers travaux d’assèchement. Les premières terres dites hautes apparurent à la lisière de la ville à partir du Xème siècle avant de gagner petit à petit l’ancien marécage boueux traversé par l’Aa.
L'essor maraîcher du XVIIIème et du XIXème siècle
La population du marais connaît une croissance sensible au XVIIIe siècle. La fin progressive du système féodal permet un meilleur partage des terres et favorise l’installation de nombreuses familles maraîchères.
C’est à cette époque, en 1751, que le chou-fleur d’été est planté pour la première fois dans les sols fertiles du marais audomarois. Ce légume deviendra l’un des emblèmes agricoles du territoire.
Puis vient la Révolution industrielle, qui bouleverse l’économie locale. En 1848, l’arrivée du chemin de fer ouvre de nouveaux débouchés pour les maraîchers. Les légumes du marais peuvent désormais être expédiés rapidement vers les grandes villes, notamment Paris.
À la belle saison, au mois de mai-juin, les marchands des quatre-saisons parcourent les rues de la capitale en vantant à haute voix les qualités des « Premiers Saint-Omer » : des légumes frais, venus tout droit du marais.
Les maraîchers du marais audomarois à la Belle Epoque
Entre 1850 et 1870, près de 400 familles s’installent pour cultiver les terres de Saint-Omer, Clairmarais et des communes voisines.
Cette période coïncide avec le déclin de l’exploitation de la tourbe, longtemps extraite par les greppeurs, les anciens tourbiers du marais audomarois.
L’apparition du charbon de terre, exploité massivement dans les houillères de l’Artois, rend ce combustible végétal obsolète. La tourbe ne sera plus utilisée qu’en période de guerre ou de pénurie.
Pour compenser cette perte d’activité, les maraîchers se tournent vers de nouvelles cultures.
En 1920, ils débutent la production de l’endive d’hiver, un légume qui permet d’assurer un revenu complémentaire en basse saison.
À côté du chou-fleur d’été, l’endive devient une autre spécialité agricole locale, illustrant la capacité d’adaptation des habitants du marais.
Le maraîchage après-guerre
Après la Seconde Guerre mondiale, le maraîchage traditionnel du marais audomarois entame un lent déclin.
La concurrence internationale, les progrès techniques et l’émergence de nouveaux modes de production rendent cette agriculture de plus en plus difficile à maintenir.
Autrefois, les parcelles du marais n’étaient accessibles qu’en bateau. Le maraîcher utilisait le bacôve, une embarcation à fond plat, manœuvrée à la perche. Elle lui servait à transporter ses récoltes — parfois jusqu’à 3,5 tonnes de choux-fleurs —, mais aussi son cheval, indispensable à son travail sur les terres.
Après-guerre, certains allaient jusqu’à jumeler deux ou trois bacôves côte à côte pour y charger un tracteur, illustrant les tentatives d’adaptation à la modernité.
À côté du bacôve, l’escute faisait office de petit utilitaire. Plus maniable, elle servait à transporter la famille, les outils ou de petites charges.
Elle se faufilait dans les rivières étroites et se manœuvrait avec une ruie, une longue rame plate utilisée comme un levier ou une godille.
Avant l’arrivée des moteurs thermiques, puis électriques, certains maraîchers aisés équipaient leur embarcation d’un motogodille, l’ancêtre du moteur hors-bord.
Le grand remembrement (1972 - 1984)
À la fin des années 1970, le marais audomarois est profondément transformé par une vaste opération de remembrement.
Des chemins agricoles et des ponts sont aménagés, rendant plus de 500 hectares accessibles par voie terrestre.
Dès lors, les bateaux traditionnels deviennent inutiles, relégués à des usages secondaires ou touristiques.
Les faiseurs de bateaux, autrefois indispensables, ferment un à un les portes de leurs ateliers.
La mécanisation offre alors une bouffée d’oxygène au maraîchage local, permettant à l’activité de survivre face à une concurrence croissante.
Mais le recul est net. Le nombre de familles vivant du maraîchage diminue de décennie en décennie :
200 dans les années 1970,
110 à la fin des années 1990,
60 à la fin des années 2000,
et moins de 35 aujourd’hui.
Ce lent effacement marque la fin d’un mode de vie ancestral, celui d’un marais cultivé par l’eau, pour et avec l’eau.
Le maraîchage aujourd'hui - Entre traditions et adaptation
De nos jours, les maraîchers du marais audomarois poursuivent leur activité avec des approches variées.
Certains travaillent en monoculture, alternant chou-fleur l’été et endive d’hiver. D’autres perpétuent une agriculture diversifiée, parfois en culture biologique.
En tout, près de 50 variétés de légumes sont encore cultivées dans le marais. Parmi eux :
le chou-fleur d’été,
l’endive d’hiver,
le chou,
le céleri-rave,
l’artichaut Gros Vert de Laon,
et la carotte de Tilques, emblématique du territoire.
Dans les marais cultivés, il n’est pas rare de croiser un maraîcher ou un saisonnier, debout dès 4 h du matin, travaillant “à la fraîche” pour récolter les choux-fleurs.
La coopérative les attend en fin de matinée : les livraisons s’effectuent souvent avant midi, pour assurer la fraîcheur du produit.
Cette scène se répète chaque année, notamment entre juillet et août, pendant la période de “full”, lorsque le chou-fleur d’été est à son apogée.
Un savoir-faire qui perdure, entre gestes ancestraux et réalités contemporaines.

Extraction de tourbe, culture du chanvre et pêche dans le marais audomarois
En plus des activités maraîchères confiées aux brouckaillers, le marais audomarois a longtemps permis le développement d’autres activités économiques.
On y extrayait notamment la tourbe, utilisée comme combustible pour le chauffage domestique. De nombreux étangs actuels, comme celui du Romelaere, sont les vestiges de ces anciennes zones d’extraction.
Le marais accueillait aussi la culture du chanvre, destiné à la fabrication des cordages de bateaux.
Les habitants, quant à eux, étaient aussi d’excellents pêcheurs, inventifs et ingénieux.
Techniques de pêche d’antan
Si aujourd’hui seule la pêche à la ligne est autorisée (et uniquement avec un permis de pêche valide), il en allait tout autrement autrefois.
On pratiquait alors des méthodes variées, souvent collectives et astucieuses, aujourd’hui interdites :
la pêche à la nasse ou au tambour,
la fouenne, un trident planté dans le poisson,
les blots et fagots, pièges à anguilles,
la puchette et la poisenette, épuisettes artisanales.
Ces pratiques populaires, transmises de génération en génération, font partie du patrimoine vivant du marais, bien que leur usage ait disparu.
La pêche à la houppe, une spécialité audomaroise
Avant que l’anguille européenne ne soit une espèce protégée, les Audomarois pratiquaient une pêche typique : la pêche à la houppe.
Elle consistait à agiter dans l’eau une pelote de vers de terre lestée de plomb, jusqu’à ce qu’une anguille y morde. Il fallait alors la ferrer d’un coup sec, avant qu’elle n’ouvre la gueule par réflexe, puis la capturer dans un parapluie retourné.
Ce geste ancestral, aujourd’hui révolu, témoigne d’une connaissance fine du comportement animal, et d’un lien intime entre l’homme et son marais.
Les fêtes traditionnelles du marais audomarois
Si certaines fêtes ont disparu au fil du temps — comme le cortège de Lyzel, autrefois composé de chars défilant entre la route de Clairmarais et la rue Saint-Martin à Saint-Omer — d’autres continuent de rassembler les foules.
Deux événements majeurs font encore battre le cœur des Audomarois chaque été :
Le cortège nautique du Haut-Pont, organisé le dernier dimanche de juillet. Dans ce faubourg emblématique, les barques décorées défilent sur l’eau, sous les applaudissements.
Le pèlerinage en bateau du 15 août, en direction d’une statue de la Vierge située au croisement du Grand Large et de la rivière d’Écou, à Tilques. Ce moment spirituel et populaire mêle recueillement et attachement au marais.
La ville de Saint-Omer entretient également la tradition des géants du Nord portés.
Batistin, figure centrale, représente un jardinier du marais du Bachelin.
Il est accompagné de sa compagne Belle-Lyze.
Véritable mascotte populaire, Batistin a donné son nom à plusieurs projets locaux, témoins de la vivacité de cette figure dans la culture audomaroise :
– Un fromage produit par la ferme du Milou à Tatinghem
– Un bacôve de la Maison du Marais
– Un gîte de France à St Omer, aux portes du marais audomarois
– Un jardin partagé au coeur de la ville

Une promenade dans le marais de Saint-Omer et de Clairmarais
Le meilleur moyen de découvrir le marais de Saint-Omer et de Clairmarais reste sans conteste le bateau.
À bord d’une escute ou d’un bacôve traditionnel, les derniers faiseurs de bateaux vous invitent à une balade au fil de l’eau, entre rivières paisibles, parcelles cultivées et faune sauvage. Un voyage dépaysant et authentique, au cœur d’un paysage façonné par l’homme depuis des siècles.
Pour les amateurs de balades terrestres, le marais offre aussi plusieurs chemins agricoles, sentiers de promenade et circuits de randonnée accessibles à pied ou à vélo.
Parmi les itinéraires les plus appréciés :
le sentier du Lansbergue, entre Tilques et Serques,
et le sentier de la cuvette, reliant Clairmarais, Nieurlet et Noordpeene.
👉 Consulter ici le livret complet des sentiers pédestres de l’Audomarois (PDF)
Enfin, la réserve naturelle du Romelaere, à deux pas de Clairmarais, propose un parcours de plus de 2 km, balisé et accessible aux personnes en situation de handicap.
Des postes d’observation ornithologiques jalonnent le chemin, permettant de découvrir :
les saules têtards,
les prairies humides,
les anciennes tourbières, devenues étangs,
et de nombreuses espèces d’oiseaux, dont certaines protégées.
Pour enrichir votre visite, un audio-guide gratuit est disponible à l’entrée du parc, à la Grange Nature, espace d’accueil et de sensibilisation à l’environnement.
Que ce soit sur l’eau, à pied ou à vélo, le marais audomarois se dévoile avec humilité et majesté, pour peu que l’on prenne le temps de l’écouter.

En bref, un lieu d'exception
Il est certain que le marais audomarois, que certains appellent marais de Saint-Omer, marais de Clairmarais ou encore hortillonnages de Saint-Omer, est plein de promesses pour celui et celle qui aime le calme, la nature et les destination dépaysantes pleines d’authenticité.